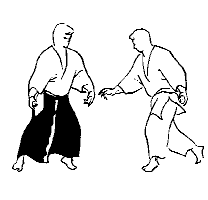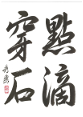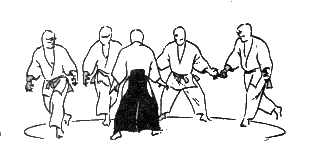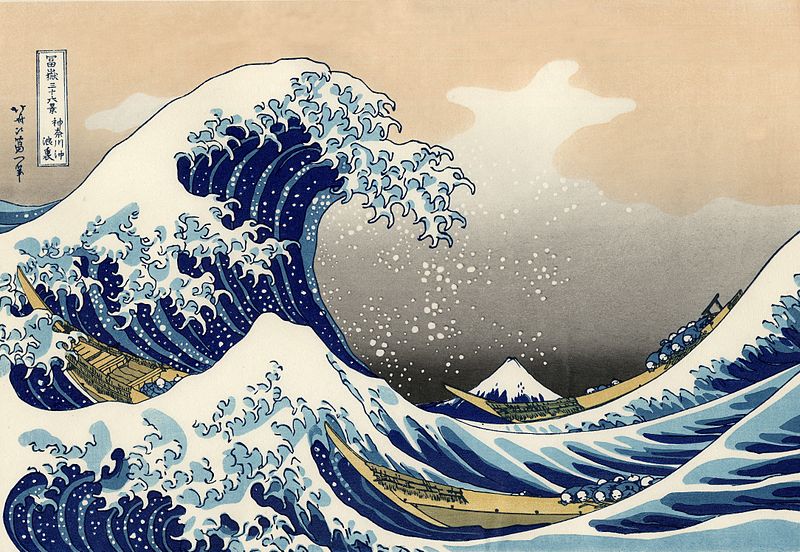Malcom Tiki Shewan pratique l'escrime dès son plus jeune âge. A 19 ans, il fait la connaissance de maître Tamura. Dès lors, il se consacre à l'Aïkido et obtient son diplôme d'enseignant en 1974. Nous lui avons posé quelques questions sur son parcours d'enseignant. Mais c'est sa vision de la logique martiale et de la résolution des conflits qu'il nous livre dans un même élan. Un échange passionnant.
Aïkidoka Magazine. : Comment en vient-on à l'enseignement ?
Tiki Shewan : En France, le système encourage les personnes qui passent un Brevet d'Etat Premier Degré à ouvrir une salle et à enseigner. Les deux fédérations fonctionnent de la même façon. Le bagage technique du B.E. ne suffit pas nécessairement pour faire un professeur. Il crée le contexte du métier. Il faut ensuite de nombreuses années de travail complémentaires avant de devenir réellement compétent. Les enseignants commencent généralement à enseigner très tôt dans leur parcours d'Aïkido, avec un bagage technique moins que complet, si on peut dire.
Ma vision de l'enseignant est assez sévère. Il doit maîtriser sa discipline. Pour cela un bon nombre d'années s'avèrent nécessaire. D'un côté je voudrais dire : « Prenez votre temps et enseignez quand votre bagage est suffisant », et en même temps je reconnais qu'un débutant, d'un niveau premier dan par exemple, est capable de transmettre quelque chose.
Je me souviens d'un stage d'enseignants avec maître Tamura, un tour de table était fait pour savoir ce que les gens pensaient du mot « maître ». J'ai avancé la vision suivante : « un maître serait capable d'enseigner une partie d'une discipline et à travers sa démonstration, les personnes présentes pourraient ressentir toute la grandeur de la discipline ». J'ai rencontré cette situation quelques rares fois en Aïkido. Peut-être faut-il arriver à atteindre un certain stade de simplicité. On dit toujours que tout devient simple pourvu qu'on ait dépassé le stade de la complexité. Je crois essentiellement que l'Aïkido va se trouver dans des choses très simples, simples comme tout.
A.M. : Que retenez-vous comme points marquants de votre parcours d'enseignant ?
T.S. : Boucler un cercle. Partir dans le compliqué pour revenir aux choses simples. Comment respirer dans un mouvement, comment rester centré, comment tenir son corps de façon naturelle, comment avoir un esprit tranquille. Mais ce n'est pas quelque chose que l'on peut enseigner. On peut donner l'exemple, on peut le reconnaitre chez quelqu'un qui l'a. Il n'y a pas de formule exacte.
Avant tout, l'enseignant devrait évaluer correctement ce qu'il est capable de donner. Cela peut être déprimant quand on se rend compte qu'on ne peut pas transmettre énormément. En 75, en tant que Délégué Technique Régional de l'UNA (NDLR : Union National d'Aïkido), j'ai été amené à enseigner. Quant je me suis trouvé devant 60 ou 80 personnes, je me suis demandé : quoi faire ? Bizarrement, pendant un an ou deux, je me suis contenté de familiariser les gens à la chute sur les différentes projections. Travailler avec l'autre dans une situation d'entraînement. Ainsi, j'étais aussi obligé de montrer le mouvement de projection sur lequel on allait travailler. Il y avait des gens plus anciens que moi, plus vieux et ce n'est pas évident de leur dire : « Votre mouvement n'est pas au point ». Je préférais me taire et montrer comment on peut chuter, comment on peut encaisser un mouvement.
A.M. : Voulez-vous dire qu'il faut apprendre en premier la fonction d'uke ?
T.S. : Pas vraiment. Au sabre, la personne qui attaque, celui qui subit le mouvement était très souvent le maître. Le maître montrait le mouvement. Dans un enseignement vraiment traditionnel, le maître attaquait et l'élève essayait d'exécuter le mouvement correctement. Le maître avait l'expérience et la vision correcte pour pouvoir corriger par sa gestuelle, par son positionnement, le défaut de la technique ou les points particuliers à prendre en compte. Cela ne peut pas se faire aujourd'hui avec un enseignement de base.
Dans certains stages, il y a 400 personnes sur le tapis. Comment voulez-vous que l'enseignant puisse voir chacun aussi longtemps qu'il le faudrait ? Il essaie de dire un mot à chacun. Mais c'est plutôt une « démonstration interactive ». On démontre le mouvement et les élèves sont livrés à leurs propres moyens pour le découvrir. Sans être forcément mauvais, ce n'est sans doute pas la façon la plus rapide pour progresser. Les erreurs commises passent inaperçues mais le corps enregistre quand même ce mouvement inexact. Ensuite il faudra peut-être du temps avant de s'en débarrasser. On espère que les plus anciens travailleront avec les moins expérimentés et qu'ils amèneront les corrections. L'enseignement et l'apprentissage sont beaucoup plus aléatoires qu'ils ne le seraient dans un Dojo traditionnel avec 10, 15 ou 30 élèves au maximum.
A.M. : Pourquoi un tel engouement des Français pour l'Aïkido?
T.S. : C'est un mystère effectivement. Je n'ai pas encore d'explication. Mais c'est un fait, il y a proportionnellement plus de pratiquants en France qu'au Japon (NDLR : en absolu aussi par rapport au Japon) ou aux Etats-Unis. Une succession de très bons professeurs japonais ont été amenés à vivre en France. Le premier qui est venu, je crois, était Minoru Mochizuki. Ensuite Tadashi Abe dans les années 50. Ces deux personnes ont été des maîtres d'un excellent niveau. Ils ont su galvaniser l'intérêt d'un petit noyau de gens qui se sont regroupés d'une manière solidaire. Dans les années 60, à l'arrivée de maître Noro, de maître Nakazono et de maître Nobuyoshi Tamura, ce groupe avait déjà une très bonne idée de ce qu'est l'Aïkido. L'enthousiasme de ces jeunes professeurs a fait le reste.
A.M. : Pensez-vous que l'absence de compétition permette à n'importe qui de pouvoir pratiquer ?
T.S. : La compétition est une application qui va forcément demander des modifications ou des adaptations d'un art martial. Le javelot, le tir à l'arc étaient à l'origine des exercices militaires. Les soldats, en plus de la guerre réelle, bénéficiaient de tout un entraînement qui pouvait s'avérer dangereux.
Pour adapter une activité martiale à un sport, on enlève les éléments dangereux. Il y a trois choses qu'on fait pour cela :
a) Modification des mouvements et des techniques. Par exemple dans le Jiujutsu, les clés de bras existent encore, mais les clés de genoux, qui induisent facilement que celui-ci se déboite, ne sont plus permises,
b) Modification des armes qu'on utilise,
c) Ajout de protections.
Par exemple dans le sabre, on a qualifié les techniques autorisées, on a remplacé l'adversaire par un shinaï en bambou, et comme c'était encore trop dangereux, on a mis une protection, une armure. C'est devenu le Kendo.
Dès qu'on veut faire de la compétition, il faut modifier ou la technique, ou l'arme, ou les armures, ou une combinaison équilibrée de ces éléments. Bien sûr, la compétition permet aux adversaires de sortir indemnes de la confrontation tout en se donnant à fond. Cependant l'art martial est transformé et il risque peut-être de ne plus rien avoir à voir avec ses origines.
Un autre exemple, un sine qua non du sport est l'égalité initiale des protagonistes en terme de poids, de grade, de compétence etc. Alors que la première règle d'un art martial est de ne s'attaquer à l'ennemi que si on possède au moins 60% de supériorité par rapport à l'adversaire ! Quel intérêt présenterait pour les spectateurs un match de foot où une équipe de collégiens se mettrait face à une équipe de première division ?
L'Aïkido a évité l'aspect compétitif pour toutes ces raisons. Il y a des valeurs intrinsèques dans cette discipline que nous voulons conserver. Pour ces valeurs, il n'est pas nécessaire d'aller vers un sport, vers une compétition, mais bien au contraire de conserver le plus possible l'intégrité technique. D'ailleurs, la véritable compétition, c'est avec soi-même.Ce qui est négatif en compétition, c'est que quelqu'un qui veut être champion cultive généralement un ego démesuré. Le positif vient le jour où il est renversé. Il peut alors changer, réfléchir. Pour une personne qui devient champion, il y en a des milliers qui n'arrivent à rien. Cela donne aussi le but ultime : se vaincre soi-même.
Ce qui est négatif en Aïkido, c'est que la correction de l'ego par la compétition, par la perte lors d'une compétition, n'existe pas. On obtient donc aussi des ego démesurés et qui ne sont pas facilement résolus.
Les deux approches peuvent donner de bons résultats. Tous les Budos, de forme compétitive ou non, se rejoignent par cette notion de Do. Qu'est-ce que l'homme là-dedans, qu'est-ce qu'il devient ?
Tout le monde réalise que la violence ne résout rien. Quand deux sabreurs s'engagent dans un combat, seuls trois résultats sont possibles :
- Le rouge gagne et le bleu perd,
- Le bleu gagne et le rouge perd,
- Le rouge et le bleu perdent tous les deux.
Dans un engagement qui a recours à la violence, il n'y a que 30 % de chance de s'en sortir gagnant. Vous sentez-vous capable d'aller voir votre banquier et de lui demander un prêt en lui disant : « J'ai 66% de chance de ne pas pouvoir vous rembourser »? Aucun homme d'affaire ne s'engagerait dans un pari aussi stupide. Pourquoi alors l'Humanité persiste-t-elle à voir des solutions dans la Guerre ? Où est l'intelligence dans le règlement des conflits par la violence ? Sans avoir recours à des principes spirituels de paix, rien qu'en calculant le pourcentage de chance de gagner un conflit, on se rend compte que la violence n'est pas la bonne solution.
A.M. : L'apprentissage de la résolution des conflits vous semble majeur ?
T.S. : Oui, la résolution des conflits sans recours à la violence est l'un des points qu'une personne peut réaliser dans un art martial. Cela peut prendre des années. Car il paraît facile de croire que l'accumulation de techniques rende plus fort et permette de vaincre les autres. Il existe des techniques très différentes pour résoudre un conflit. Prenons un exemple occidental moderne : lors d'une manifestation, on fait appel aux CRS, des spécialistes qui ont pour objectif de désamorcer la violence dans un cadre civil sans faire de blessés. Si l'on faisait appel à groupe de combat de guerre, leurs moyens pour le résoudre seraient des blindés et des mitrailleuses. Cela résoud peut-être la situation mais ce n'est absolument pas applicable à une situation civile.
Des différences de ce type existaient dans l'ancien Japon. Certaines techniques de l'aristocratie guerrière japonaise avaient pour but de résoudre des situations potentiellement conflictuelles voire meurtrières sans avoir recours au meurtre (comme le désarmement). Le problème pouvait être résolu, n'entraînant aucune poursuite. Une technique de ce type n'était pas employée dans un contexte guerrier mais dans un contexte de société. On peut imaginer que l'Aïkido est issu de cela.
Prenez suwariwaza et son importance en Aïkido. Personne ne se met à genou sur un champ de bataille. Se mettre à genou était la façon la plus détendue de se tenir et il fallait être capable de réagir si quelqu'un vous attaquait. Cet aspect de l'Aïkido nous indique le cadre historique d'où la discipline nous est venue.
Ou encore dans l'Aïkido, il n'y a aucun enseignement de techniques offensives. On n'apprend pas formellement à attaquer. Le but n'est pas celui de l'anéantissement de l'adversaire. Ceci aussi est un indicateur de l'esprit de la discipline. Beaucoup d'arts martiaux d'aujourd'hui ont été influencés par une époque de paix. Il fallait détourner l'attention des guerriers vers d'autres activités dés 1610. Calligraphie, poésie, thé, etc... La notion de Do est apparue vraiment dans un monde sans guerre.
A.M. : Je vous remercie pour cet échange enrichissant.
Septembre 2007